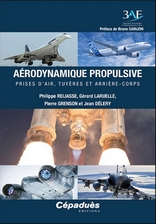Nous sommes chaque jour bluffés par les performances d’évolution et de furtivité des avions de chasse de cinquième génération, par la récupération du premier étage de la mégafusée Starship ou par bien d’autres de ces exploits qui peuvent apparaître aux yeux du grand public comme de petits miracles. Le cœur des recherches qui ont permis ces avancées c’est l’aérodynamique propulsive. Quatre auteurs de très haut niveau se sont réunis pour nous présenter cet imposant (542 pages !) ouvrage technique traitant de ce sujet. C’est bien entendu un livre s’adressant en priorité aux élèves ingénieurs concernés, et au public proche : autres étudiants des filières scientifiques, ingénieurs, chercheurs et enseignants. Mais, au-delà des formules mathématiques et physiques, c’est un important travail de description des phénomènes, très pédagogique dans son approche, favorisant une bonne aisance de la compréhension. De nombreux exemples passés, présents et parfois à l’état de projets sont présentés à titre d’illustration, on dispose ainsi de véritables catalogues des configurations.
L’ouvrage commence par deux chapitres de rappels de dynamique des gaz et de notions d’effort propulsif, ainsi que des théorèmes généraux associés.
Puis on entre dans le vif du sujet en prenant l’écoulement général comme fil (d’Ariane bien sûr) conducteur, et donc de l’avant vers l’arrière, avec trois grandes parties du livre pour les prises d’air (sept chapitres, 160 pages), pour les tuyères (8 chapitres, 176 pages) et pour l’arrière-corps (4 chapitres, 78 pages).
Comme dans Marius de Pagnol (1), on apprécie même un quatrième tiers : le dernier chapitre de la section « tuyères » est consacré à l’exemple de la fusée Ariane 5. On y mentionne bien entendu les très nombreux vols réussis, mais on s’arrête surtout sur les quatre vols marqués par un échec, en analysant les problèmes rencontrés, les causes liées aux sujets de notre étude (tuyères et arrière-corps), parfois en voulant bien faire, le mieux étant quelquefois l’ennemi du bien, et surtout les remèdes apportés.
Les annexes sont riches : foncions isentropiques, polaires et intersections de chocs, notion de couche limite, formules et relations utiles, nomenclature, bibliographie (16 pages !), listes de sigles et abréviations. Les auteurs, Philippe Reijasse, Gérard Laruelle, Pierre Grenson et Jean Délery, tous ingénieurs, chercheurs, enseignants, responsables de projets et directeurs de grands programmes, et leur comité de lecture, sont également présentés en annexe. Comme la plupart sont ou ont été des acteurs majeurs de l’ONERA, on retrouve de très nombreuses illustrations provenant de cet organisme. On aurait toutefois pu trouver une petite annexe rappelant que l’emplacement des souffleries concernées est glissé dans les désignations de ces équipements (2).
L’ensemble est traité de manière scientifique non seulement par son contenu, mais également dans sa présentation : notes de bas de pages, références en fin d’ouvrage, nombreuses illustrations légendées lorsque de source connue. L’ensemble est net et sans bavures (3).
L’aérodynamique propulsive est passionnante, et cet ouvrage vous permettra de bien saisir le problème… par les deux bouts !
Jean-Noël Violette
Notes :
1) Dans Marius, le personnage de César explique la composition du Picon-citron-curaçao :
« César prend un grand verre, une carafe et trois bouteilles. Tout en parlant, il compose le breuvage. Tu mets d’abord un tiers de curaçao. Fais attention : un tout petit tiers. Bon. Maintenant, un tiers de citron. Un peu plus gros. Bon. Ensuite, un BON tiers de Picon. Regarde la couleur. Regarde comme c’est joli. Et à la fin, un GRAND tiers d’eau. Voilà. »
2) Exemples « MA » pour Modane-Avrieux dans S1MA, S2MA, S3MA ou S4MA, « Ch » pour Chalais dans R2Ch, S2Ch ou S5Ch.
3) Pour montrer le haut niveau de relecture, nous n’avons trouvé que bien peu de « pétouilles » :
– une référence « voir la figure 2.4 » qui semble plutôt concerner la figure 2.5 page 63 ?
– on ne comprend pas bien le pourquoi d’un écoulement « de la droite vers la gauche » page 118 ;
– un « rhombe de Mach » douteux page 118 ;
– page 156, on ne distingue pas bien ce qui relève vraiment des groupes turbopropulseurs, sujet du paragraphe, et ce qui est plutôt du domaine des propulseurs thermiques (citation du Jodel, illustration Trigull 320…)
– une typo page 274 (double virgule dans -0,0,05 ) ;
– une petite erreur de date pour une occurrence du lancement raté d’Ariane 5, le 11 décembre 2002 (et non pas le 12 décembre, page 474) ;
– dans la liste des sigles, on aurait pu ajouter « MDBA » cité comme « héritier de l’Aérosptiale » dans le texte, qui aurait pu rappeler les entreprises-mères : Matra Défense, BAe Dynamics, Aérospatiale, Alenia Marconi Systems.